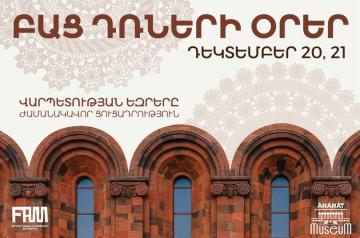Du 27 avril au 3 mai 2025, la ville de Gyumri, en Arménie, a accueilli la 25e édition du colloque international du Réseau des Écoles d’Architecture francophones. Organisé par l’Université nationale d’architecture et de construction d’Arménie (UNACA), l’événement a réuni huit écoles, dont cinq françaises, ainsi que des délégations d’Ukraine, de Pologne et d’Arménie. Le thème choisi pour cette édition, « Espaces oubliés : la frontière stagnante entre l’ancien et le nouveau », a permis d’aborder les tensions entre préservation du patrimoine et développement urbain dans un contexte marqué par l’histoire et la résilience.
Par Layla Khamlichi-Riou
Une histoire de coopération francophone
L’Arménie, membre du réseau francophone, affiche depuis longtemps une forte affinité avec la culture et les institutions françaises. Depuis les années 90, explique Arev Samuelyan, enseignante à l’UNACA, « nous sommes très francophiles. Nos premiers échanges internationaux sont avec les écoles d’architecture de France. C’était Paris-Villemin et l’école Luminy à Marseille. Et maintenant on a de très bonnes relations bilatérales avec l’école nationale supérieure d’architecture de Clermont-Ferrand, de Saint-Étienne, de Lyon, de Grenoble et de Strasbourg ».
Cette année, ce sont cinq écoles françaises, ainsi que des partenaires d’Ukraine, de Pologne et d’Arménie, qui ont répondu à l’invitation. L’Arménie étant la seule école d’architecture du pays, c’est elle qui porte l’organisation, peu importe la ville choisie.
Gyumri : ville témoin, ville d’expérimentation
Gyumri, deuxième ville du pays, incarne à elle seule la thématique du colloque. Son centre historique, classé en zone de protection sous le nom de « Kumairi », contient un patrimoine bâti unique datant essentiellement de la seconde moitié du XIXe siècle. C’est « un tissu des îlots » qui a été en grande partie préservé, contrairement à Erevan, précise Arev Samuelyan. Mais Gyumri est aussi une ville touchée en profondeur par le tremblement de terre de 1988. Il reste aujourd’hui encore « des stigmates sur le corps de la ville », et de nombreuses constructions récentes ont été insérées dans ce tissu historique.
Ce contraste entre bâtiments anciens et nouvelles constructions a offert un terrain d’analyse riche pour les étudiants, qui ont été invités à proposer des solutions concrètes, intégrant les problématiques de conservation, d’habitat et de réhabilitation.
Une pédagogie du collectif et du réel
Durant toute la semaine, les délégations d’enseignants et d’étudiants ont travaillé ensemble sur des projets architecturaux à partir de sites précis de Gyumri. L’approche pédagogique repose sur la coopération : « Les étudiants qui connaissent déjà le site, donc je parle des Arméniens, et les étudiants dont ils ont la première approche, et les différentes écoles, les approches différentes des différentes écoles, ça donne vraiment... on ne va pas dire que ça va être construit, parce que c’est quand même un projet d’étudiants. Mais voilà, comprendre comment les autres travaillent. Travailler ensemble ».
Les projets ont ensuite été présentés devant un jury composé des représentants de l’université, de la chambre des architectes d’Arménie, et de l’architecte en chef de la ville de Gyumri, nouvellement nommé.
Le colloque n’avait pas pour objectif de produire un projet gagnant en vue d’une réalisation. Ce qui comptait, c’était la collaboration, le processus. « Ce n’est pas tellement important qui a gagné. Tout le monde a gagné. Ce qui m’a marqué, c’est que les gens, tout le monde, tous les âges, et les enseignants, et les étudiants, ont été marqués par la vie ».
L’essentiel : tisser des liens, apprendre autrement
Ce travail intensif en groupe dans un environnement inconnu a permis aux étudiants d’expérimenter les réalités du métier d’architecte : apprendre à travailler vite, dans des conditions concrètes, en tenant compte de contraintes multiples, qu’elles soient urbanistiques, patrimoniales ou sociales. Samuelyan le souligne clairement : « L’architecture, la profession d’architecte, ce n’est pas seulement la création pure et seule. Il faut que tu fasses avec beaucoup de contraintes. Des contraintes qui peuvent devenir des atouts dans ton projet ».
Au-delà de l’apprentissage, c’est une expérience humaine riche, porteuse de collaborations futures : « Il y a eu des nouveaux liens humains entre collègues. Et les nouveaux, futures collaborations. Et la manière de travailler ensemble, la façon de travailler ensemble, quand pendant une semaine vous êtes, en quelque sorte, confinés dans le même espace, et vous pensez, vous travaillez ensemble ».
Une ouverture vers d’autres projets
Cette dynamique ne s’arrête pas avec la fin du colloque. Le 12 mai prochain, une conférence scientifique internationale aura lieu à l’UNACA, avec la participation d’experts venus de France. Elle portera sur la protection du monastère de Tatev et des zones voisines, dans le cadre d’un dossier en cours pour une inscription à l’UNESCO. « L’ambassade de France est un partenaire civilisé dans le projet, parce qu’on prépare le dossier pour l’inscription sur la liste de l’UNESCO », indique Samuelyan.
Le prochain colloque du Réseau des Écoles d’Architecture se déroulera à Lyon. L’école nationale supérieure d’architecture de Lyon en sera l’hôte. Le thème n’a pas encore été communiqué, car, comme le rappelle Samuelyan, « l’école qui va accueillir va préparer le projet et va envoyer quelques mois avant. Et voilà, c’est un travail d’un semestre, et après sur place, ils font une sorte de workshop ». D’ici là, les participants repartiront de Gyumri avec des perspectives renouvelées, des idées partagées, et un regard plus riche sur ce que signifie bâtir dans un monde fait de strates, de ruptures et de dialogues entre les temps.