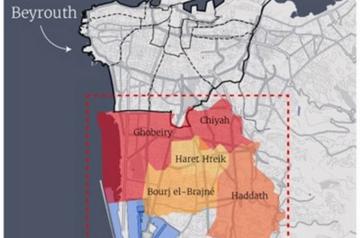L’emprise de la poésie est unique. Elle peut nous éloigner de la réalité, nous entraîner ailleurs, en marge de l’esprit. Les mots nous emportent et aident à révéler ce qu’on cherche à l’intérieur parfois même sans le savoir. Cette introspection à travers la poésie interpelle et permet une observation différente de soi-même et du monde extérieur. Nous avons discuté à ce propos avec Tsov Alizé Banuchyan, une auteure arménienne, qui part à l’observation des états d’âmes à travers notamment les villes qu’elle a traversées : Erevan, Montpellier, Paris.
Par Luciné Abgarian
Quand et comment vous avez commencé à écrire ? Pourquoi le poème ?
J’ai commencé à écrire très tôt, avant même d’aller à l’école. Depuis toute petite, je voulais être écrivaine ; mon père transcrivait mes premiers « poèmes » que je récitais oralement, et je croyais vraiment que cela faisait de moi déjà une poétesse.
Un poème c’est comme un souffle, tu respires mieux quand tu l’écris, quand tu le chantonnes, cela te facilite la respiration, c’est aussi comme un vent doux, comme un alizé venant de la mer. Je suis amoureuse de ma langue maternelle, l’arménien, et je dis souvent que c’est l’amour vers les mots qui se dégage de ma poésie.
Par ailleurs, j’écris énormément de prose, mais ces textes, je les publie plus rarement, car une prose demande plus de responsabilité et de travail. Souvent j’abandonne temporairement mes écrits sans les confier au lecteur. J’ai un roman rangé dans un tiroir depuis des années, il me faut un peu plus de courage pour y revenir.
Qu’est-ce que vous avez notamment tendance à relever à travers vos vers ?
Je ne suis pas une personne très sentimentale, mais ma poésie exprime une certaine fragilité, et souvent mes lecteurs disent que j’arrive à toucher leurs âmes à travers mes vers, que je donne des mots à ce qu’ils peuvent ressentir, mais qu’ils n’arrivent pas à exprimer eux-mêmes.
J’ai aussi créé une femme forte qui se promène à travers mes lignes. J’ose être nue en pensée, en âme et en corps dans ma poésie. Vous savez, nous vivons à une époque où il faut être courageux pour être fragile. Yves Saint Laurent disait « quand on aime, on est en danger », je dirais quand on est poète, on est en danger.
Quel est le rôle de la poésie dans le monde contemporain et comment est-elle, la poésie, à notre ère d’après vous ?
Peut-être que je me trompe, mais la poésie ne joue plus le rôle d’autrefois, celui de l’époque de Verlaine et de Rimbaud, de Maïakovski ou de Essénine. Si tu dis que tu es poète, tu es perdu. On te prendra pour un fou, qui n’a tout simplement pas réussi à choisir un vrai métier.
Tu n’arriveras jamais à notre époque, à transformer le monde dans la poésie, comme cela a été auparavant. Néanmoins, tu peux le rendre plus beau, tu peux combler la solitude éternelle des gens, d’ailleurs les vrais poètes sont les serviteurs de la solitude, de la leur, aussi bien que de la celle des autres.
Le rôle du poète dans la société s’est également transformé, sa manière de communiquer avec le lecteur aussi. Avez-vous un format propre de communication ?
Je communique avec le lecteur assez facilement. Je leur donne tout de ma poésie en toute transparence, parfois même les choses que les mots essayent de cacher.
Je dis souvent que la poésie doit avoir la possibilité de choisir son lecteur sans cibler un public précis. Une fois écrit, le poème, en version numérique ou papier, peu importe, doit vivre sa vie, voyager d’une poche à l’autre, d’une bouche à l’autre. Si les gens oublient ton nom mais récitent tes poèmes, cela veut dire que tu as réussi à faire passer ta création avant toi, que ta création te dépasse.
Vous faites actuellement une recherche en art numérique, comment vous arrivez à lier, à « marier » ces deux activités, et comment s’entraident-t-elles ?
Je ne les « marie » pas, je fais tout pour que ces deux restent « célibataires ». Je réussis à laisser mon monde littéraire loin de mes engagements et de mes obligations. J’ai même un bureau devant lequel je m’assois seulement pour écrire et jamais pour travailler sur mes créations numériques ou sur mes recherches.
La littérature est un espace à part, dans lequel je rentre vidée et libérée des préoccupations, je me sens totalement dévouée à la page blanche qui m’attend.
Votre recueil « Trois villes » (2017) regroupe les poèmes écrits dans trois villes différentes. Avec un regard rétrospectif, à quel point ces villes ont marqué votre identité ?
Chaque ville a transmis son caractère, sa façon de vivre, ses secrets. Les poèmes ressemblent aux villes dans lesquelles ils étaient écrits. Erevan a nourri mes rêves, Montpellier m’a permis de les réaliser, Paris m’a rendue plus réaliste et plus forte, mais ces trois villes m’ont gâté à tel point que je n’ai jamais su les abandonner, je dirais même que je suis accrochée à ces villes.
Est-ce qu’il y a des problématiques que vous aimeriez relever à travers votre littérature ?
En ce moment, je réfléchis beaucoup à cette question. Je ne veux pas faire des projets artificiels, inventer des raisons pour lesquelles j’aimerais avoir une plume beaucoup plus engagée. On peut dire que je suis en période de silence, j’écris en silence. Je ne suis pas sûre que la révélation de certaines problématiques spécifiques pourrait résoudre ces problèmes. J’aimerais donner des réponses qui pourraient changer quelque chose dans nos mentalités, dans nos engagements, dans notre lutte quotidienne pour défendre notre identité, j’y réfléchis beaucoup, on verra…
Quelle place retrouve l’aménité dans votre poésie ?
Je suis amoureuse de ma langue maternelle et même le peu de traductions de ma poésie montrent à quel point j’aime chérir cette langue, aller au-delà du rythme et des mots. Je n’ai pas besoin de montrer spécifiquement l’arménité dans ma poésie, car ma poésie est arménienne, et parfois il m’est impossible de la traduire, il est impossible de me traduire, c’est pourquoi je me transforme souvent en autre personne en passant d’une langue à l’autre.
Découvrez l'un des poèmes de Tsov Alizé Banuchyan traduit en français et publié dans le recueil "Les femmes (se) racontent. Expériences dans le PECO" (2017, Roumanie).
Telle Némésis
Quand pour la première fois on m'a permis de choisir ma
robe,
J'ai cru déjà tenir le monde dans mes mains,
J'ai emprunté aux femmes leurs gestes et leurs
mouvements
Laissant la première robe sur toutes mes traces.
Mais je savais, depuis très longtemps, que mon corps
Était en danger dès qu'il cherchait l'amour,
Que dans les miroirs, gardiens de la nuit, la femme libre
Encore au matin, fêtait la fin de cet amour.
Le rouge de mes lèvres allait triompher d'eux, toujours
Et mes pensées fanées allaient se fondre dans l'arôme des
roses
Et moi chaque fois j'allais à genoux aux pieds du destin
Promettre de ne plus laisser piétiner mon cœur.
Après ma première robe, j'ai décidé de ma vie,
J'ai signé sous mes pleurs et mes rires,
La faiblesse des femmes, je l'ai toujours haïe
J'ai joué de ma faiblesse pour paraître forte.
Telle Némésis, le cygne endormi sur mes genoux,
J'ai jeté à nouveau mon amour au vent,
La première robe, à présent dans la valise délaissée
Où me mène cette impasse ? Je ne sais plus.
Tsov Alizé Banuchyan
Traduit par Yvette-Nvard Vartanian
Contribution de Claire Heberle